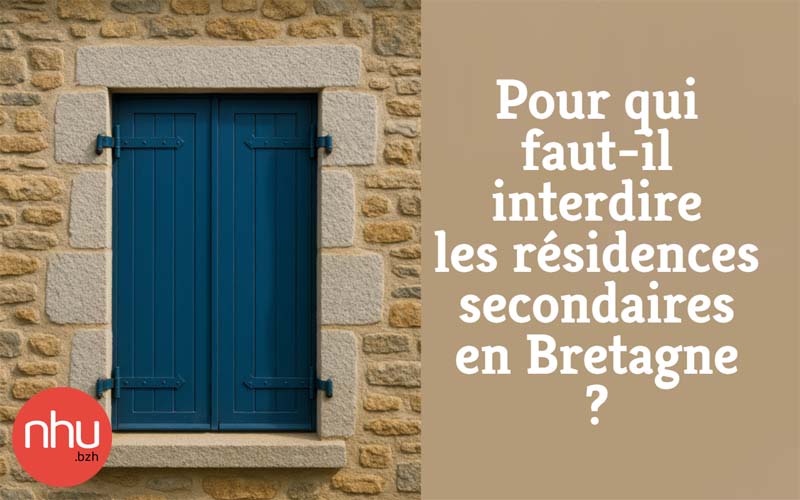Sommaire
Interdiction des résidences secondaires en Bretagne : Cancale / Kankaven, une première en Bretagne
Interdiction des résidences secondaires en Bretagne.
Cancale / Kankaven, cité maritime du nord de la Bretagne orientale, vient de marquer l’histoire locale. Le conseil municipal a voté une interdiction inédite : plus aucune nouvelle résidence secondaire ne pourra y être construite.
La mesure repose sur la loi Echaniz–Le Meur, adoptée fin 2024. Cette loi permet aux communes d’imposer une servitude de résidence principale. Chaque logement neuf doit être occupé au moins huit mois par an. En cas de fraude, l’amende peut atteindre 1 000 € par jour, plafonnée à 100 000 €.
Iñaki Echaniz et Annaïg Le Meur sont respectivement députés de Euskadi / Pays Basque et de Bretagne : deux pays où se pose tout particulièrement le problème de prolifération des résidences secondaires.
Cette décision répond à une évolution inquiétante. Entre 2011 et 2022, la part de résidences secondaires à Cancale / Kankaven a bondi de 35,5 % à 41 %. Parallèlement, le nombre de meublés touristiques, dont beaucoup proposés via Airbnb Bretagne, a explosé.
Conséquence : les habitants permanents peinent à trouver un logement abordable.

Un défi commun aux nations celtiques
La Bretagne n’est pas seule. Dans d’autres nations celtiques, la flambée des prix immobiliers et la pression des résidences secondaires provoquent des tensions similaires. Cornouailles, Pays de Galles affrontent le même défi.
Ces pays ont réagi plus tôt et parfois plus fortement. Ils démontrent que des solutions existent pour éviter que les villages, surtout côtiers, deviennent des musées vides une grande partie de l’année.

Cornouailles : surtaxe de 100 % pour freiner la spéculation
En Cornouailles, voisine celtique de la Bretagne, la crise est particulièrement aiguë. Dans certains villages, plus de la moitié des logements sont occupés seulement quelques semaines par an. Les jeunes Cornouaillais sont poussés à quitter leur terre natale.
Depuis avril 2025, le Cornwall Council applique une surtaxe de 100 % sur la taxe locale des résidences secondaires. Les propriétaires paient donc le double de la Council Tax. Cette politique vise à réduire la spéculation et à ramener des logements sur le marché.
Des résultats se font sentir. Certains biens sont revendus, d’autres redeviennent accessibles à l’année. Cependant, des contournements existent : des propriétaires déclarent leur logement « en vente » pour éviter la surtaxe. Cette limite prouve qu’une réponse uniquement fiscale doit s’accompagner de contrôles solides.

Pays de Galles / Cymru : surtaxe massive et protection linguistique
Au Pays de Galles / Cymru, la réaction est encore plus radicale.
Depuis 2023, les communes peuvent appliquer une surtaxe allant jusqu’à 300 % sur les résidences secondaires. Dans le Gwynedd, où la proportion est très forte, ce taux maximal est en vigueur.
Ici, l’enjeu dépasse l’économie. Il touche directement la langue galloise. Quand les jeunes ne trouvent plus à se loger, ils partent. Le nombre de locuteurs baisse, les écoles ferment, les communautés se fragilisent.
Certaines communes galloises exigent même une autorisation spécifique avant de transformer une résidence principale en meublé touristique. Résultat : le nombre de résidences secondaires s’est stabilisé. Des logements reviennent sur le marché de la résidence principale.
Cette politique montre qu’il est possible d’agir vite et fort. Elle prouve aussi que le logement est un levier central pour défendre une langue et une culture.
Pays Basque / Euskadi : deux réalités distinctes
Le Pays Basque / Euskadi illustre bien l’importance des outils institutionnels.
Au nord, même cadre que la Bretagne
Dans le Pays Basque nord, sous administration française, plusieurs communes ont suivi le même chemin que Cancale / Kankaven.
Bayonne / Baiona , Biarritz , Anglet / Angelu, Bidart / Bidarte et Boucau/ Bokale interdisent désormais les nouvelles résidences secondaires dans certains secteurs. Ces décisions reposent sur la loi Echaniz–Le Meur, comme en Bretagne.
Au sud, l’avantage de l’autonomie
Au sud, la Communauté Autonome d’Euskadi et la Navarre disposent de pouvoirs fiscaux et urbanistiques propres. Elles ont instauré des politiques plus adaptées : fiscalité spécifique, quotas, aides directes aux jeunes résidents. Ces outils, inexistants au nord, renforcent leur efficacité.
Le contraste est net. Quand un pays dispose d’autonomie, il agit plus vite et plus fort. Le Pays basque sud peut protéger son logement bien mieux que le nord, encore dépendant des décisions du pouvoir central de Paris.
Bretagne : vers un statut de résident ?
En Bretagne, Cancale / Kankaven a montré la voie. Mais la mesure ne concerne que les logements neufs. Les milliers de résidences secondaires existantes échappent à toute régulation.
D’où l’intérêt d’un statut de résident Bretagne. Ce dispositif donnerait la priorité aux habitants permanents. Il pourrait :
- réserver une part des logements aux résidents à l’année ;
- moduler la fiscalité en fonction de l’usage réel du logement ;
- imposer un seuil maximal de résidences secondaires par commune ;
- limiter la durée des locations touristiques à quelques mois par an.
Un tel statut protégerait la vie sociale, l’économie locale et la langue bretonne. Car sans habitants permanents, il n’y a ni transmission culturelle, ni continuité de services.
Si vous n’êtes pas résident permanent en Bretagne depuis au moins cinq ans, vous ne pouvez pas acquérir une résidence secondaire.
Interdiction des résidences secondaires en Bretagne pour préserver la vie locale et culturelle
Limiter les résidences secondaires en Bretagne aurait plusieurs bénéfices.
D’abord, la préservation des écoles, des commerces et des services publics. Ensuite, une meilleure stabilité des prix immobiliers, freinant la spéculation. Enfin, un soutien indirect à la langue bretonne, qui ne peut survivre sans familles enracinées et présentes toute l’année.
Bretagne, choisir la vie
Cancale / Kankaven vient d’ouvrir une brèche. Les exemples de Cornouailles, du Pays de Galles et du Pays Basque montrent que des solutions plus fortes existent déjà.
Il appartient désormais aux élus bretons de décider.
La Bretagne veut-elle suivre le chemin des villages fantômes, réservés aux vacanciers fortunés ?
Ou veut-elle bâtir un modèle inspiré de ses cousins celtiques et du Pays Basque, tous trois autonomes, où le logement reste un droit pour les habitants permanents ?
Ce choix déterminera la Bretagne de demain.
Une terre vidée, ou une Bretagne vivante et transmise aux générations futures.
Interdiction des résidences secondaires en Bretagne