Sommaire
Angles, Saxons, Jutes… et la fin d’un monde
Invasions germaniques et chute de Rome.
Pendant plusieurs siècles, Rome a tenu d’une main ferme l’ouest de l’Europe. Son autorité, son administration, son armée structuraient l’ordre. Mais à partir du IIIe siècle, des craquements annoncent déjà la fin d’un monde. Au Ve siècle, l’Empire romain d’Occident s’effondre, balayé par une série de chocs venus de l’est.
Les Bretons, eux, se retrouvent au cœur de la tempête.
Un monde romain affaibli
Depuis le Bas-Empire, Rome perd pied. Les frontières deviennent poreuses, les crises politiques se succèdent, l’économie s’essouffle. L’Empire s’était appuyé sur des peuples “fédérés”, installés aux marges pour défendre ses confins. Mais ces peuples, les Germains notamment, ne tardent pas à devenir une menace bien plus grave.
Pendant que les Huns de l’effrayant Attila bousculent les royaumes germaniques, d’autres peuples – Saxons, Angles, Jutes – se tournent vers l’ouest. Non pas pour piller, mais pour s’y établir durablement. La Britannia romaine, isolée et abandonnée à elle-même, devient une cible idéale.
L’effondrement de la Britannia
En 410, l’empereur Honorius envoie une lettre aux cités de Bretagne (l’actuelle Grande-Bretagne) : Rome ne viendra plus à leur secours. Les légions sont parties, rappelées vers le continent. La Bretagne insulaire, romaine depuis quatre siècles, est désormais livrée à elle-même.
Dans le vide laissé par Rome, les anciens citoyens romains doivent se défendre seuls. Mais sans armée, sans administration centrale, et face à des envahisseurs bien organisés, leur marge de manœuvre est réduite. C’est une période de transition brutale, marquée par la peur, le repli, et un retour progressif à des formes de pouvoir local.

Angles, Saxons, Jutes : des “migrants” pas comme les autres
Ces peuples venus de Germanie – aujourd’hui entre la mer du Nord et l’Elbe – n’ont rien de hordes barbares sans vision. Les Saxons, Angles et Jutes ne veulent pas seulement piller : ils veulent s’installer, cultiver la terre, fonder des royaumes.
Ils débarquent d’abord dans le sud-est de l’actuelle Angleterre, souvent à l’invitation de chefs bretons dépassés qui espèrent les utiliser comme mercenaires contre d’autres tribus. Erreur fatale : les mercenaires se muent en envahisseurs, puis en conquérants.
Ces nouveaux venus repoussent les populations brittoniques vers l’ouest (actuels Pays de Galles et Cornouailles) ou vers la mer. C’est là qu’intervient l’autre grande conséquence de cette période : le départ massif de Bretons vers l’Armorique.
Et c’est là que surgira la figure héroïque d’Arthur, à jamais Roi des Bretons.
Une Bretagne insulaire devenue “anglo-saxonne”
Les chroniqueurs postérieurs appelleront cette période les Dark Ages – les âges sombres. Du point de vue brittonique, en effet, c’est un cauchemar. Les villes déclinent ou sont abandonnées, les routes romaines tombent en ruine, les grandes villas s’effacent sous les ronces.
En quelques générations, les langues brittoniques sont effacées de l’est et du centre de l’île. Le latin aussi disparaît. À leur place, se développe une mosaïque de dialectes germaniques, futurs embryons de l’anglais. Ce sont les fondations de l’Angleterre : le land of the Angles.
Mais tout ne disparaît pas. Dans l’ouest, les populations brittoniques résistent. Et certaines prennent la mer.
Direction : l’Armorique.
Des réfugiés… et des fondateurs
C’est ici que la Bretagne armoricaine entre dans l’Histoire avec force. Dès la fin du IVe siècle, des Bretons avaient commencé à traverser la Manche, souvent comme militaires ou colons. Mais à partir du Ve siècle, ce sont de véritables vagues migratoires.
Ces Bretons apportent avec eux leurs langues, leurs coutumes, leurs saints, et surtout une volonté de survivre. On ne quitte pas sa terre sans raisons graves : leur migration est une réponse à une défaite existentielle.
Ils vont fonder les premiers royaumes brittoniques de l’ouest armoricain : Domnonée, Cornouaille, Bro Waroch… Ce sont les racines de la Bretagne telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Chute de Rome, naissance d’un peuple
Pendant ce temps, sur le continent, l’Empire romain vit ses derniers instants. En 476, le chef germanique Odoacre dépose le dernier empereur romain d’Occident. La chute est symbolique : cela fait déjà longtemps que Rome n’est plus maîtresse chez elle.
Mais cet événement marque la fin officielle d’un empire qui aura structuré l’Europe pendant cinq siècles. L’ordre impérial laisse place à une Europe fragmentée, instable, où les anciennes provinces se réorganisent en royaumes plus ou moins durables.
Pour la Bretagne, cette période n’est pas seulement celle d’un effondrement. C’est aussi une reconfiguration profonde. Ce que les Bretons ont perdu en Britannia, ils vont en partie le reconstruire en Armorique.
Et dans l’est armoricain ?
L’arrivée massive de Bretons dans l’ouest de l’Armorique n’a pas transformé immédiatement toute la péninsule. À l’est, dans ce qui deviendra plus tard la Bretagne orientale, les anciennes structures gallo-romaines perdurent plus longtemps. Mais peu à peu, la langue bretonne progresse, les saints bretons fondent leurs monastères, et les anciens Gaulois armoricains adoptent la nouvelle culture bretonne.
C’est le lent travail du temps. Une fusion complexe entre Bretons migrants et populations locales. Une alchimie historique qui donnera naissance, au fil des siècles, à une Bretagne unie par deux langues, une culture, une mémoire.

Une Histoire encore trop méconnue
Il est frappant de constater combien cette période capitale est absente des récits scolaires français. On y parle abondamment des “invasions barbares”, mais presque jamais de la migration bretonne, pourtant attestée et fondatrice.
Pour comprendre ce qu’est la Bretagne, il faut pourtant passer par cette séquence. Elle n’est pas une province figée de l’Empire, mais le fruit d’un exil, d’un arrachement et d’une reconstruction.
Les Bretons sont un peuple né d’une rupture, d’une traversée, et d’un enracinement.
Cette histoire, c’est celle d’un peuple qui refuse de disparaître.
Retrouvez les précédents épisodes
15 siècles plus tard …
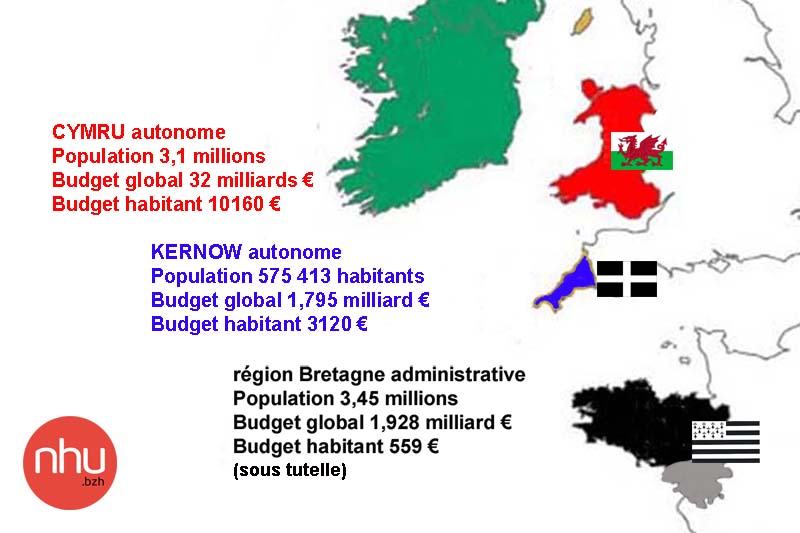
#HistoireDeBretagne
#RacontonsNotreHistoireNousMemes
Invasions germaniques et chute de Rome : illustration header designed by FreePik
Prochain épisode à paraître Dimanche 13 Juillet : Émigration bretonne vers l’Armorique occidentale



2 commentaires
Coïncidence, cette semaine j’ai eu l’occasion de discuter de Bretagne avec un jeune « breton » (22 ans), niveau Bac+2.
Sa connaissance de la Bretagne était du niveau 0 (zéro). Totale ignorance, j’ai abordé quelques points présents dans votre article, il tombait des nus, moi j’avais pitié.
Puis avec le recul je me suis souvenue qu’il m’était arrivée des choses similaires avec des vieux, brittophones de naissance…
Très bien ! Mais vous oubliez de dire que
1°/ Que l’Armorique s’étendait alors (à minima) de l’embouchure de la Loire à l’embouchure de la Seine.
2°/ Que beaucoup de Bretons migrèrent également sur les cotes (plus proches) de la Normandie d’aujourd’hui.
3°/ Que St Iudoc, un moine breton, construisit un monastère dans cette ville qui s’appelle aujoud’hui Montreuil sur mer, à l’embouchure de la Seine.
4°/ Que les Brétigny, Bretteville, Bretignolles, Breteil, Bretonneux, Brétesche etc… en sont des réminiscences.
5°/ Que tous ces Bretons ont été très vite assimilés dans cette région armoricaine (Neustrie) ou l’on ne parlait plus le gaulois depuis longtemps, et qui était alors entièrement gallo-romanisée.,
6°/ Que dans l’extrême Armorique (Domnonée) les Armoricains parlaient encore le gaulois armoricain, une langue celtique très proche du breton.
7°/ Que si les Bretons ont migrés en extrême Armorique, c’est surtout, parce qu’ils ont été « accueilli » par des Armoricains qui avaient la même langue qu’eux et qu’elle était peu peuplée. Ailleurs la romanisation, depuis quatre siècles de la Gaule, avait fait son oeuvre.