Sommaire
Nationalité bretonne et citoyenneté française : comprendre la différence
Nationalité bretonne et citoyenneté française.
Beaucoup de gens confondent nationalité et citoyenneté.
En France, les deux notions sont volontairement fusionnées. Pourtant, elles ne désignent pas la même chose.
Un Breton peut affirmer être de nationalité bretonne tout en restant citoyen français. Ce n’est pas un paradoxe. C’est une réalité historique, identitaire et politique.
Cette confusion n’est évidemment pas innocente.
Elle résulte d’un choix idéologique : celui d’un État centralisé qui nie l’existence des nations autres que la sienne. Pour comprendre pourquoi les Bretons insistent sur cette différence, il faut plonger dans l’histoire, dans le droit et dans la philosophie politique.
Nationalité et citoyenneté : définitions de base
En droit français, la nationalité désigne le lien juridique qui rattache un individu à l’État. Elle figure sur la carte dite « nationale » d’identité. La citoyenneté, elle, correspond au droit de participer à la vie politique de cet État : voter, être élu, exercer certains droits civiques.
Dans la plupart des États modernes, ces deux notions sont liées mais distinctes. On peut être de nationalité étrangère mais citoyen d’un autre pays par naturalisation. On peut aussi être apatride, donc sans nationalité, tout en résidant et votant ailleurs.
La France, elle, a choisi de fusionner ces concepts. Le citoyen est censé se confondre avec le national. Cette approche gomme les identités multiples et impose l’idée qu’il n’existe qu’une seule nation : la « nation française ».
Comment la France a imposé sa « nationalité unique »
Cette fusion entre nationalité et citoyenneté ne s’est pas produite par hasard. Elle est le résultat d’une construction idéologique et politique.
- 1789 : la Révolution française proclame l’existence d’un peuple français unique. Les habitants de Bretagne, d’Alsace, de Corse ou du Pays Basque sont déclarés « Français », qu’ils le veuillent ou non.
- XIXᵉ siècle : l’école de Jules Ferry diffuse ce discours. Les langues régionales sont interdites à l’école. Parler breton vaut une punition. L’objectif est clair : fabriquer des Français en effaçant les nationalités historiques.
- XXᵉ siècle : les guerres mondiales renforcent ce processus. Les Bretons, comme les autres peuples de l’Hexagone, meurent en masse pour la France. La République transforme ce sacrifice en argument d’assimilation.
La « nationalité française » s’est donc construite sur l’effacement des autres nationalités. La Bretagne, la Corse, l’Alsace ou la Savoie ont été intégrées dans ce récit national unique.

Une distinction pourtant universelle
Dans beaucoup d’autres pays, la distinction entre nationalité et citoyenneté est claire et assumée.
- Irlande du Nord : depuis les accords du Vendredi Saint (1998), chaque habitant peut se dire de nationalité irlandaise, britannique, ou les deux, tout en restant citoyen du Royaume-Uni.
- Écosse et Pays de Galles : les recensements officiels permettent de se déclarer de nationalité écossaise ou galloise, sans que cela contredise la citoyenneté britannique.
- Catalogne : la Constitution espagnole impose la citoyenneté espagnole. Pourtant, la Generalitat reconnaît une « nationalité catalane », présente dans certains documents administratifs.
- Québec : beaucoup affirment être de nationalité québécoise, mais citoyens canadiens. Les partis souverainistes utilisent cette distinction depuis des décennies.
Ces exemples montrent que l’on peut être citoyen d’un État sans renoncer à sa nationalité d’origine. Ce n’est ni contradictoire ni illégal : c’est un fait sociologique et politique.
La vision du droit international
Le droit international reconnaît la différence entre peuple et État. Les Nations unies affirment le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Or, pour qu’un peuple existe, il n’a pas besoin d’État. Il lui suffit d’avoir une histoire, une langue, une culture et une conscience collective.
C’est la situation de nombreuses nations sans État : les Écossais, les Catalans, les Kurdes, les Basques, les Flamands, les Corses, et bien sûr les Bretons.
Dans ce cadre, la nationalité n’est pas un simple document administratif. Elle est l’expression d’une appartenance à un peuple. La citoyenneté, elle, n’est qu’un lien temporaire avec un État donné.
La Bretagne dans ce contexte
La Bretagne illustre parfaitement cette distinction. Historiquement, elle a été une nation souveraine, dotée de ses propres lois, institutions et diplomatie. L’annexion de 1532 a effacé cette souveraineté politique, mais pas l’existence nationale.
Aujourd’hui encore, de nombreux Bretons affirment clairement :
👉 « Je suis de nationalité bretonne, mais de citoyenneté française. »
Cette phrase exprime à la fois une identité profonde et une réalité politique imposée. Elle rappelle que la citoyenneté est circonstancielle, tandis que la nationalité bretonne est existentielle.

La Bretagne, une nation niée mais vivante
La Bretagne n’a évidemment pas disparu avec l’annexion française de 1532. Sa nationalité n’est plus reconnue par l’État central, mais elle vit dans la langue, la culture, la mémoire collective et le sentiment d’appartenance de son peuple.
- Une langue historique : le breton, parlé depuis plus de mille ans, et le gallo, langue romane spécifique de Bretagne orientale.
- Une culture foisonnante : des festoù-noz classés au patrimoine immatériel de l’UNESCO, à la musique contemporaine inspirée par la tradition.
- Un territoire clair : de Brest à Klison, cinq départements forment une réalité historique et humaine que rien n’efface.
- Une mémoire résistante : des révoltes paysannes aux luttes modernes pour la langue et l’environnement, les Bretons n’ont jamais cessé d’affirmer leur singularité.
Dire « je suis de nationalité bretonne » n’est donc pas un slogan militant.
C’est simplement constater que la Bretagne reste une nation, malgré l’effort constant de Paris pour la réduire à une « région administrative ».
Être citoyen français malgré tout
En pratique, le Breton vit dans un État : la République française. Cela lui confère la citoyenneté française.
Cette citoyenneté lui donne le droit de :
- voter aux élections françaises et européennes,
- être élu dans les institutions de l’État central,
- bénéficier des droits sociaux (sécurité sociale, retraite, éducation),
- être protégé par le droit français et européen.
Elle lui impose aussi des devoirs : payer l’impôt, respecter les lois, participer éventuellement à la défense du pays.
Mais cette citoyenneté française n’efface pas la nationalité bretonne. Ne devrait pas.
Elle définit seulement les règles d’une cohabitation politique. De nombreux peuples vivent la même situation. Les Catalans, les Écossais ou les Québécois participent à la citoyenneté imposée par leur État, tout en revendiquant une nationalité propre.

Conséquences politiques et philosophiques
La distinction entre nationalité et citoyenneté change tout.
- Identité : la nationalité bretonne est une identité profonde, enracinée dans l’histoire. La citoyenneté française est une identité administrative et politique, temporaire par nature.
- Légitimité : reconnaître la nationalité bretonne, c’est admettre que la Bretagne est une nation et non une simple « région », voire « province ».
- Avenir : un peuple qui affirme sa nationalité possède le droit de choisir son destin, y compris son indépendance.
Cette distinction a été largement discutée par les penseurs.
La Breton Ernest Renan, dans sa conférence de 1882 Qu’est-ce qu’une nation ?, parlait d’un « plébiscite quotidien ».
Mais cette définition gomme les continuités historiques et culturelles. D’autres, comme le philosophe allemand Johann Gottlieb Fichte, insistaient au contraire sur la langue et la culture comme fondements de la nationalité.
La Bretagne incarne ce second modèle.
Sa langue, sa culture, son histoire et son sentiment d’appartenance définissent une nationalité qui dépasse de loin les cadres administratifs français.
Ne serait-ce pas la raison, ou une des raisons, de l’acharnement du pouvoir central et de ses serviles valets en Bretagne, à éradiquer notre langue : plus de langue bretonne, et plus de nation bretonne.
Comparaisons internationales
Les Bretons ne sont pas isolés. Partout en Europe, des nations sans État revendiquent leur existence nationale.
- Écosse : le référendum de 2014 a montré que l’idée de nationalité écossaise est largement partagée, malgré l’appartenance au Royaume-Uni.
- Catalogne : en 2017, un référendum interdit a réuni des millions de personnes autour de la nationalité catalane.
- Québec : les référendums de 1980 et 1995 ont montré une forte volonté d’affirmer la nationalité québécoise.
- Flandre : en Belgique, la nationalité flamande s’exprime à travers un mouvement politique puissant, qui revendique plus d’autonomie.
- Corse et Sardaigne : en Méditerranée, ces îles rappellent que la diversité nationale est une réalité du continent.
La Bretagne s’inscrit dans cette dynamique européenne. Sa revendication d’une nationalité propre n’est ni marginale ni exotique : elle est au contraire en phase avec l’évolution de l’Europe des peuples.

La dimension européenne
L’Union européenne distingue déjà deux niveaux :
- la citoyenneté européenne, qui découle de la citoyenneté d’un État membre,
- la nationalité, qui reste la compétence exclusive des États.
Cela montre bien que citoyenneté et nationalité ne sont pas synonymes. Pourtant, la Bretagne reste invisible dans ce système. Elle ne possède aucune reconnaissance en tant que nation. Son existence est absorbée par l’État français.
Demain, une Europe plus démocratique pourrait accorder une place aux nations sans État. Les Bretons auraient alors la possibilité de cumuler une citoyenneté européenne et une nationalité bretonne reconnue, sans passer par la médiation de Paris.
La réalité vécue aujourd’hui
Au-delà du droit, il y a la vie réelle. Et là, la nationalité bretonne se voit partout.
- Dans les sondages : une majorité de Bretons déclarent se sentir autant bretons que français, et parfois plus bretons que français. Chez les jeunes, ce sentiment s’accentue.
- Dans les symboles : le Gwenn ha Du flotte dans les festivals, les stades, les manifestations. Il est reconnu partout comme un drapeau national.
- Dans la langue : le regain de l’enseignement du breton, la signalétique bilingue, la toponymie défendue par les habitants.
- Dans la culture populaire : des artistes, écrivains et musiciens revendiquent leur nationalité bretonne. Glenmor chantait déjà : « Je ne suis pas Français, je suis Breton. »
Cette vitalité prouve que la nationalité bretonne n’est pas une invention politique. Elle est une réalité sociologique et culturelle vécue par des centaines de milliers de personnes.
Une citoyenneté bretonne, demain ?
Si la nationalité bretonne est déjà vécue, la citoyenneté bretonne reste à inventer. Elle pourrait se traduire par :
- le droit de voter pour un parlement breton souverain,
- la possibilité de définir nos propres lois,
- la gestion directe de nos impôts et de nos ressources,
- une représentation internationale de la Bretagne.
Une telle citoyenneté bretonne ne serait pas exclusive. Elle pourrait coexister avec une citoyenneté européenne, comme c’est le cas pour les citoyens écossais ou catalans dans l’UE.
La nationalité bretonne existe, même si l’État français refuse de la reconnaître.
Elle s’exprime dans la langue, la culture, la mémoire et l’identité vécue des habitants. Elle ne doit pas être confondue avec la citoyenneté française, qui n’est qu’un statut administratif lié à l’appartenance actuelle à un État.
Affirmer la distinction entre nationalité bretonne et citoyenneté française, c’est refuser l’assimilation.
C’est proclamer que la Bretagne est une nation vivante, digne de respect et de reconnaissance.
Aujourd’hui, le Breton est de nationalité bretonne et de citoyenneté française.
Demain, il pourrait être de nationalité et de citoyenneté bretonnes. Cette perspective n’est pas une utopie, mais une possibilité offerte par l’histoire.
L’affaire de la famille Manrot-Le Goarnig
Contexte et lutte
D’abord, Jean-Jacques et Mireille Manrot-Le Goarnig choisissent des prénoms bretons pour leurs douze enfants. Ensuite, l’état civil refuse ces prénoms à la fin des années 1950. L’administration les juge « étrangers » et invoque la loi du 11 germinal an XI. Ainsi, la famille perd des droits et subit des blocages concrets. En 1963, Mireille entame une grève de la faim et connaît la prison.
Un combat judiciaire long et symbolique
Puis, le couple engage des procédures à Rennes et jusqu’à la Cour de cassation. En 1966, la loi évolue, toutefois la réforme ne s’applique pas rétroactivement. Malgré tout, les parents poursuivent l’action et maintiennent la pression publique. Par leur ténacité, ils imposent le débat sur les prénoms bretons.
Finalement, selon Le Télégramme :
« c’est la Cour européenne de justice qui donnera raison aux époux Le Goarnig. Les enfants non reconnus par l’État français recevront la citoyenneté « européenne de nationalité bretonne » ! »
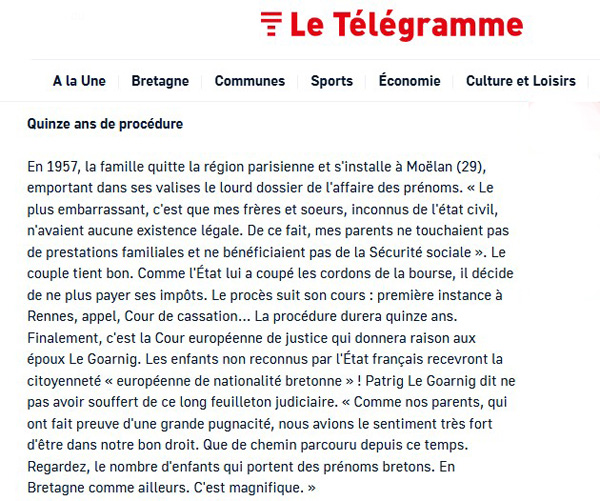
Une reconnaissance juridique forte
Par la suite, la presse régionale relaie l’issue du dossier. Surtout, l’affaire crée un précédent symbolique et juridique en Europe. En conséquence, la pluralité des nationalités culturelles gagne en légitimité publique. Aujourd’hui encore, ce combat éclaire la distinction identité nationale et citoyenneté.



4 commentaires
La Nationalité Bretonne a perdurée officiellement jusqu’en 1870. Puisque Napoléon III
avait ordonné en 1851 que soit versé une pension aux familles Bretonnes survivantes de la Révolution en Bretagne.
Ce n’est qu’avec l’avènement de la IIIe république, que le Breton et toutes les langues régionales ont été interdites.
Il fallait imposer la République une et indivisibles…
Les algériens(4 départements français), les vietnamiens, l’Afrique et toute l’Indochine ont pu apprécier ses bienfaits…
Comment pourrait on revendiquer la nationalité bretonne en par exemple avec un carte d’identité formelle ou un passeport moins gadget que l.actiel
« l’effort constant de Paris pour réduire la Bretagne à une région administrative »
… à laquelle il manque la Loire-Atlantique !! On ne le répètera jamais assez.
Le statut de ladite région administrative n’est pas le principal problème, qui est son contour.
J’ai enquêté sur les Le Goarnig il y a une dizaine d’années. Non seulement il n’y aucune trace de cette soi-disant décision de la Cour européenne (oui c’était avant l’internet mais les archives existent) mais j’ai eu plusieurs enfants Le Goarnig au téléphone et même sa secrétaire devenue sa dernière compagne Nolwenn Le Gac. Aucun de ses enfants n’a eu cette soi-disante carte d’identité européenne. Quant à Nolwenn Le Gac qui lui avait survécu quelques années, et qui avait toutes les archives, elle n’avait jamais vu aucun document à ce sujet. Jean-Jacques Le Goarnig a publié plusieurs livres. Aucun de ses livres ne comporte une reproduction d’un quelconque document provenant de la Cour européenne. Il faudrait arrêter d’affirmer ou de répéter des trucs sans aucune vérification.